
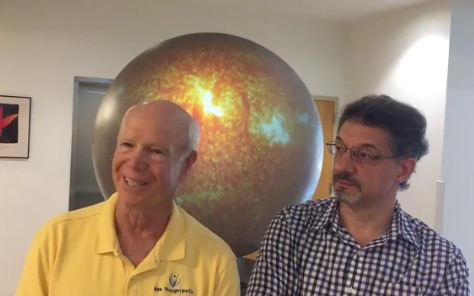
D’un point de vue réchauffiste, on s’étonnera que les vilains climatosceptiques stipendiés ne se soient pas jetés comme un seul homme sur ces travaux, afin de les brandir comme une preuve irréfutable de l’innocence du dioxyde de carbone. Ces recherches ont été discutées par eux et le sont encore, puisqu’elles reviennent de temps à autre sur le devant de la scène, surtout médiatique.
L’article de Nikolov et Zeller datant de 2017 est consultable ici. On en trouvera de plus anciens sur la toile.
Leur théorie a fait parler d’elle récemment en français grâce à un article traduit, paru sur le site La Terre du futur.
Le physicien de l’atmosphère Roy Spencer en a récemment parlé sur son blog, en reprenant un ancien argument de Willis Eschenbach. Ned Nikolov lui a répondu. Comme il avait déjà répondu, avec son collègue Karl Zeller, à un article critique de Willis Eschenbach en 2012.
Les lecteurs curieux, lisant l’anglais et suffisamment versés dans la physique pourront s’en donner à cœur joie, car la discussion se poursuit longuement dans les commentaires.
Le propos de cet article n’est pas de commenter ces échanges, encore moins de trancher, mais de prendre en compte le fait que nombre de lecteurs de l’article paru dans La Terre du futur ne sont guère au courant du contexte et pensent que pour la première fois une alternative est donnée à la théorie de l’effet de serre. Or, cette dernière a une histoire, qu’il n’est pas superflu de connaître quand on s’intéresse à l’évolution récente du climat et à ce qu’en disent les scientifiques, les politiques et les médias. Raison pour laquelle sont donnés ici à lire de très longs extraits de Climat, mensonges et propagande, paru fin 2010. Où il est question de l’histoire de l’influence que l’Homme a pensé avoir sur le climat, sur la naissance de la théorie de l’effet de serre et sur quelques critiques qui peuvent en être faites.
[Pour le confort de la lecture, les nombreuses références bibliographiques ne sont pas reportées]
Chapitre 1 – Un peu d’histoire
Loin des moyennes, des cartes de pression atmosphérique, des roses des vents, le climat, aussi abstrait soit-il, est cerné par l’individu, qui, pour peu qu’il soit observateur, sait généralement assez bien si le temps qu’il fait est habituel ou s’il s’écarte singulièrement de la variabilité naturelle. Pas besoin de faire appel à un spécialiste pour repérer un été caniculaire ou pourri, un hiver particulièrement doux ou très rigoureux. Chacun, aujourd’hui comme hier, effectue donc, inconsciemment et avec moins de précision (faut-il le préciser ?) la synthèse que le climatologue est en charge de mener. Mais la notion de climat, elle, est difficile à définir et a sensiblement différé au cours de l’histoire. Le terme « climat » vient étymologiquement du latin clima, lui-même emprunté au grec, qui signifie inclinaison. Il désignait à l’époque antique l’angle que font les rayons du Soleil avec la surface terrestre, inclinaison qui dépend de la latitude. Les différents climats de la Terre pour l’Antiquité grecque et romaine étaient donc des bandes parallèles à l’équateur et dépendaient de l’éloignement à celui-ci.
La tyrannie du climat
La propension à intégrer la succession des types de temps, à en faire une synthèse inconsciente permettant de savoir si l’on est dans la norme ou dans l’excès, voire à saisir une éventuelle évolution climatique, étant une faculté universelle, l’Homme de l’Antiquité en était capable, comme chacun d’entre nous. Ainsi, Théophraste, philosophe grec du IVe siècle avant J.-C., qui a beaucoup écrit sur le milieu naturel et particulièrement sur le règne végétal, a émis l’hypothèse que les déforestations entraînaient invariablement un phénomène d’assèchement par baisse des précipitations. Il y avait là les bases d’une approche de l’action de l’Homme sur le climat, action dont l’importance aurait pu être appréhendée. Les exemples de Théophraste restaient de dimension locale, mais cette théorie permettait d’envisager, sous condition de vastes déboisements, des conséquences climatiques pouvant atteindre des dimensions spatiales plus importantes, au moins régionales. Néanmoins, ce point de vue n’a pas trouvé écho chez ses contemporains, ni sous l’empire romain. Pline l’Ancien (23-79 après J.-C.), dans son Histoire Naturelle, constate également une évolution locale du climat suite à des pratiques culturales, mais il considère cependant que le climat est éminemment stable. Pour lui, c’est une constante du milieu naturel qui, malgré quelques constatations locales et secondaires, ne saurait évoluer. L’Homme ne peut avoir de réelle action sur le climat. C’est une relation totalement dissymétrique, car pour les savants de l’époque le climat définit le caractère des peuples. Ainsi, la civilisation gréco-romaine étant pour ses représentants, largement supérieure à toutes les autres, le climat qui l’a façonnée ne pouvait être que le plus favorable. Et celui sous lequel vivaient les barbares, à la limite du vivable. Que l’on s’éloigne un tant soit peu de l’empire romain et la péjoration climatique devient catastrophique. Très vite, en s’éloignant de la douceur méditerranéenne, on arrive aux limites de la zone habitable. Aux marches même de l’empire romain, Ovide, au tout début de notre ère, exilé sur les bords de la mer Noire dans une ancienne colonie grecque, décrit des tribus frustes, vivant dans un climat terrible. La peinture qu’il dresse de ce qui est aujourd’hui pour les classes moyennes et riches de Russie et d’Ukraine un lieu de villégiature estivale, est digne du Grand Nord, avec des neiges persistant au sol tout l’été, le Danube et la mer gelant tous les hivers. Même en imaginant un climat légèrement plus froid que de nos jours, il est manifeste qu’il y a exagération. Il est inenvisageable que la neige n’ait pas fondu dès le retour du printemps. La volonté d’apitoyer Rome pour mettre fin à son exil, de même que des propos emphatiques au service de son œuvre littéraire peuvent expliquer en partie cette exagération. Mais cette vision des marches de l’empire est aussi conforme à la représentation intellectuelle que l’on se faisait à l’époque des régions septentrionales bordant le limes, règne du froid implacable. De la même manière, les confins méridionaux sont la proie d’une chaleur infernale. Un siècle avant, Pline, Diodore de Sicile, qui décrit de manière similaire les régions au nord, n’est pas en reste avec le sud. Selon lui, aux confins de l’Égypte, la chaleur est telle que l’on ne distingue rien en plein midi, l’évaporation rapide réduisant considérablement la visibilité. L’évaporation de l’eau du corps est d’ailleurs tellement importante que si la soif n’est pas étanchée sur-le- champ, la mort survient en peu de temps. Et que l’on ne se risque pas à poser un pied nu sur le sol, sous peine de brûlure immédiate. Bref, dans le monde gréco-romain, la normalité climatique est de rigueur : tout éloignement vers le nord ou le sud expose à des conditions climatiques se dégradant à une vitesse inouïe, si bien que les régions en question ne sont rapidement plus habitables. La zone torride ne peut être qu’inhabitée. Au nord des steppes ukrainiennes ou de l’Angleterre, plus âme qui vive. Et, bien avant, les Hommes obligés de vivre comme des bêtes.
Une telle conception de la tyrannie du climat, facteur explicatif du caractère des peuples, va perdurer jusqu’au XVIIIe siècle. On la retrouve par exemple dans l’article Climat, écrit par d’Alembert dans l’Encyclopédie. Cette idée sera celle de presque toutes les Lumières, au premier rang desquelles Montesquieu, mais à l’exception notable de Voltaire. On a certes progressé depuis l’Antiquité dans la connaissance géographique de la Terre, les régions habitables sont plus vastes qu’on ne le croyait. Mais la conception zonale du système climatique mondial demeure, de même que le caractère univoque de la relation entre les Hommes et le climat. Les Hommes sont totalement inféodés aux conditions climatiques, au point d’être déterminés jusque dans leur couleur de peau. D’Ibn Khaldoun, historien arabe de la seconde moitié du XIVe siècle, à l’Abbé Dubos du siècle des Lumières, on croit qu’en changeant de latitude les Blancs peuvent devenir noirs et les Noirs devenir blancs. Dubos estime que cette transformation prend quelques siècles. Qu’une information erronée parvienne alors au savant, comme l’existence d’une importante population blanche au centre de l’Afrique, dont l’intérieur reste mystérieux, et l’on adapte la réalité qu’on ignore pour expliquer la théorie : le grand naturaliste Buffon fait de l’Afrique centrale le siège de hautes terres au climat compatible avec le teint clair des Hommes qui étaient supposés l’habiter.
Les caractéristiques physiques ne sont pas les seules affectées. Les Lumières pensent que les peuples du nord, âpres au travail, courageux, deviendraient, sous des latitudes plus chaudes, apathiques et médiocres. Le racisme envers les autres peuples et particulièrement le continent africain est manifeste, mais, à la décharge des philosophes de l’époque, ils ne font pas de ces défauts des éléments intrinsèques aux Hommes : résultats de la fatalité climatique, ils peuvent évoluer en changeant simplement de climat.
Progrès socio-économique et progrès climatique
Durant le XVIIIe siècle, l’idée d’une action possible et positive de l’Homme sur le climat s’impose comme un changement de paradigme : l’Homme peut désormais devenir le maître du jeu, l’âge de la Raison triomphante doit permettre à celle-ci d’agir non seulement sur la société, mais également sur le milieu naturel. L’idée moderne de Progrès s’impose. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Edward Gibbon, auteur d’une Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, considère qu’il y a suffisamment d’indices pour admettre que le climat d’Europe était plus froid à cette époque. Il justifie ainsi cette différence :
« Les travaux des Hommes expliquent suffisamment les causes de la diminution du froid. Ces bois immenses qui dérobaient la terre aux rayons du Soleil, ont été détruits. À mesure que l’on a cultivé les terres et desséché les marais, la température du climat est devenue plus douce. Le Canada nous présente maintenant une peinture exacte de l’ancienne Germanie ».
L’influence du climat étant majeure sur les civilisations, c’est lui qui explique la supposée vigueur des Germains, qui ont ainsi pu vaincre Rome. Depuis, les défrichements ont amélioré le climat, qui a lui-même eu une influence favorable sur les peuples, permettant l’instauration d’un cercle vertueux. Le progrès social et économique implique le progrès climatique qui le favorise à son tour. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, considérant lui aussi que le recul de la végétation était responsable de la douceur relative de l’Europe par rapport à la rigueur du temps hivernal nord-américain, souhaitait la même chose pour son pays. Un tel optimisme va partiellement perdurer au XIXe siècle : pour Charles Fourier (et non pas Joseph, que l’on rencontrera plus tard), la mise en culture de la totalité du globe conduirait à adoucir les climats de la Terre dans des proportions qui feraient pâlir nombre d’experts actuels : en Sibérie et au Canada, où l’amélioration pourrait atteindre 12 °C, mais aussi en Europe, où le philosophe attendait 6 °C de plus. Il faut dire que cette époque, dite du Petit âge glaciaire (finissant), n’était pas avare en hivers très rudes.
De la théorie de l’assèchement à l’effet de serre
Cette vision positive de l’action de l’Homme sur le climat par le biais de la déforestation n’est cependant pas la seule au siècle des Lumières, même si c’est celle qui domine largement. Émerge en effet peu à peu, dès la Renaissance, au sein des colonies du sud au climat tropical, une autre perception des choses. À partir de cette période s’affirme la redécouverte des écrits antiques. Les œuvres de Théophraste sont traduites et diffusées et mettent en garde les planteurs des nouvelles colonies portugaises et espagnoles, comme Madère et les Canaries, contre une possible catastrophe économique. Et de fait, dans ces colonies, il y eut concomitance entre déforestation et baisse des précipitations. En ayant eu connaissance, Christophe Colomb aurait redouté qu’un tel scénario ne se reproduise dans les Indes occidentales. Cette crainte subsistera, surtout dans les colonies concernées par les climats tropicaux. La théorie de l’assèchement, de la baisse des précipitations comme conséquence de la déforestation, contribuera fortement à la naissance de l’environnementalisme moderne, avant même que l’on se préoccupe de biodiversité.
La base contemporaine de cette théorie se trouve dans les travaux sur la transpiration des plantes, dont les fondements sont établis par John Woodward en 1699. Henri-Louis Duhamel du Monceau, botaniste et agronome français, publie en 1760 un ouvrage dans lequel il fait le lien entre arbres et climat. Ces idées seront diffusées à l’Académie des sciences et vont retraverser le Channel, où elles seront discutées à la Society of Arts anglaise, avec des académiciens français. Il n’est alors question que des colonies de latitude tropicale, les bienfaits de la déforestation n’étant pas remis en question pour l’Europe, qui en aurait largement bénéficié, et surtout l’Amérique du Nord, qui en attend beaucoup. Les observations de déforestations suivies de sécheresses dans les colonies ont été un moteur pour le mouvement de conservation de la nature. La signature du Traité de Paris (1763) mettant fin à la Guerre de Sept Ans a permis la mise en application de ces idées protectionnistes. De larges parts d’espaces montagneux d’îles des Caraïbes passées sous la loi britannique, et encore largement peuplées d’Indiens (on ne porte donc pas tort aux planteurs), deviennent ainsi des réserves forestières « pour la protection des pluies », les premières jamais créées pour prévenir un changement climatique. Des réserves similaires sont créées en 1769 sur l’île Maurice par Pierre Poivre, qui en était le commissaire-intendant, par ailleurs grand avocat de la protection des forêts coloniales. Les arguments avancés pour leur mise en place sont les mêmes que pour celle de l’Empire britannique : en 1763, Poivre fit à Lyon un discours dans lequel il lie déforestation et assèchement, qui peut être considéré comme le premier texte mettant en garde contre le changement climatique. En 1790-1791, un puissant « El Niño » eut lieu, avec comme conséquence d’importantes sécheresses dans le sud de l’Inde, à Sainte-Hélène, aux Antilles, en Amérique Centrale, en Australie. Ce fut un puissant accélérateur pour la protection attendue du climat, via celle des forêts.
Ce furent les administrations coloniales qui jouèrent le rôle principal dans la diffusion et la prise en compte de la théorie de l’assèchement ; l’influence des centres métropolitains fut relativement minime. Il y eut malgré tout un vaste mouvement de protection des forêts en Europe, surtout dans les pays ayant d’importants massifs montagneux, au premier rang desquels la France. Les références à d’éventuelles péjorations climatiques induites par le déboisement n’ont pas été l’élément décisif en l’occurrence, bien que certaines sociétés savantes départementales aient mentionné, notamment, une augmentation de la fréquence des fortes averses. En France, un ouvrage, publié en 1840 par l’ingénieur des Ponts et Chaussées Alexandre Surrel, Étude sur les torrents des hautes Alpes, va jouer un rôle majeur. Les déboisements y sont montrés du doigt et à travers eux les populations montagnardes jugées responsables des catastrophes s’abattant sur la nation. C’est à cette époque qu’est forgée l’expression « manteau forestier », en référence au pouvoir protecteur qu’on prête aux peuplements boisés. En déboisant inconsidérément, les populations montagnardes sont tenues responsables des crues catastrophiques touchant les plaines. La solution à ces maux vient de deux des grands corps d’État : les ingénieurs forestiers d’une part, qui reboisent vigoureusement au sein d’un vaste programme appelé Restauration des Terrains en Montagne (RTM), et, d’autre part, ceux des Ponts et Chaussées, grâce à des travaux hydrauliques. Cette manière de percevoir les choses est toujours d’actualité chez la majorité des ingénieurs, mais le monde de la recherche n’est pas aussi univoque, loin s’en faut. Voici ce qu’en dit l’historien du climat Emmanuel Garnier dans son dernier livre :
« Largement orchestré par le lobby des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Eaux et Forêts, ce postulat fait aujourd’hui toujours l’objet d’un débat entre spécialistes. En contradiction formelle avec les grands corps de techniciens, l’historien suisse Christian Pfister est allé jusqu’à parler d’une “carrière publique du paradigme du déboisement” qui aurait effacé la dimension climatique ».
Le climat n’a pas été invoqué en Europe dans un débat largement confisqué par le génie alors même qu’il eut été un excellent facteur explicatif, prépondérant à défaut d’être le seul. Inversement, dans les colonies, il est largement mis en avant pour justifier la protection des forêts tropicales, de manière parfois instrumentalisée par ceux ayant avant tout pour but, louable, la protection d’espaces et d’espèces jugés remarquables, sans réelle considération pour l’avenir climatique.
Les centres métropolitains vont cependant entrer dans le débat sur l’assèchement, mais aussi dans l’action. Ainsi, la création de la future administration forestière des Indes (là où auparavant n’existaient que des centres locaux) découle directement d’un rapport de 1851 pour l’Association britannique pour l’avancement des sciences (BAAS), dont le but était d’examiner les conséquences qu’aurait la destruction des forêts tropicales, notamment du point de vue des retombées économiques. Le débat va cependant prendre une autre tournure et dépasser la seule question de la déforestation. C’est encore au sein de la BAAS qu’est exposé en 1858, un article de Spotswood Wilson Sur l’assèchement progressif et général de la Terre et de l’atmosphère. Quelques années plus tard, en 1865, il en fait paraître un autre très semblable, qui est, lui, discuté à la Royal Geographical Society. La théorie de l’assèchement y est réaffirmée, particulièrement dans le deuxième article. Inspiré par les écrits de voyageurs décrivant des paysages desséchés d’Afrique, d’Australie, du Pérou, où partout l’Homme habite, Wilson explique que celui-ci est l’unique responsable. Mais il va plus loin et marque là un tournant important. Selon lui, déforestation et usage immodéré de l’eau ne peuvent suffire pour expliquer ce processus d’assèchement. Une modification des taux d’oxygène et de dioxyde de carbone en est aussi responsable. Avec cet article, peut-être le premier sur l’effet de serre anthropique, il initie un débat vraiment international sur l’environnement, en annonçant la fin de l’humanité causée par des changements dans l’atmosphère, dont elle est responsable. La théorie de l’effet de serre n’est pourtant alors que l’affaire de spécialistes, et demeure en pleine formulation.
Une analogie qui a fait florès
Les montagnes, comme on le verra plus particulièrement un peu plus tard, vont jouer un rôle d’importance dans les interrogations ayant mené à l’étude de l’effet de serre. Parmi les savants qui les ont beaucoup fréquentées, Horace-Bénédict de Saussure occupe une place à part, ne serait-ce que parce qu’il est considéré comme l’un des pères de l’alpinisme. Ce naturaliste et géologue genevois, infatigable arpenteur des Alpes, était un esprit curieux, qui n’hésitait pas à imaginer les instruments dont il avait besoin pour ses expériences. L’une d’elles est à l’origine des travaux sur l’effet de serre. Voulant comprendre pourquoi il fait plus froid au sommet des montagnes que dans les plaines environnantes, il invente l’ancêtre des capteurs solaires, qu’il nomme héliothermomètre, afin d’étudier les effets calorifiques des rayons du Soleil. La température est mesurée à l’intérieur d’une boîte composée de cinq caisses de verre emboîtées les unes dans les autres, avec un fond noir absorbant. Il a derrière la tête la volonté de montrer que le rayonnement solaire est aussi efficace en altitude qu’en plaine, malgré les plus faibles températures qui y règnent. Ce qui, implicitement, signifie que la différence de température n’est pas à chercher dans les effets directs du Soleil. L’expérience est menée en juillet 1774, en plaine et en montagne. L’élévation de température est identique dans les deux cas, malgré la différence d’altitude. Saussure explique ainsi les résultats de son expérience : sans les vitres de son dispositif, la mesure de température eut été biaisée, particulièrement en altitude, car la chaleur accumulée aurait été « en grande partie dérobée par les courants qui règnent dans l’air ». Le nombre de vitres a permis cette conservation de la chaleur et donc la comparaison entre plaine et montagne. C’est le confinement de l’air, non renouvelé, qui a empêché son remplacement par une atmosphère plus fraîche et qui est responsable du succès de l’expérience menée par Saussure. Comme une serre qui maintient l’air réchauffé à l’intérieur, où règne une température plus chaude ou douce qu’à l’extérieur, en empêchant simplement la convection : qu’une fenêtre de la serre soit ouverte et l’air chaud, moins dense que l’air plus frais de l’extérieur, s’élèverait dans l’atmosphère, tandis que l’air de cette dernière rentrerait et ferait baisser la température.
Cette expérience fondatrice de Saussure est commentée dans Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires, publiées en 1824 par le mathématicien et physicien français Joseph Fourier, qui peut s’appuyer sur les cinquante années de découvertes scientifiques qui le séparent de son prédécesseur, notamment celle de l’astronome anglais William Herschel, qui veut que tout corps rayonne, mais d’une « chaleur rayonnante », dite aussi « chaleur obscure », d’une manière différente de la lumière visible (blanche). Nous dirions maintenant que le rayonnement électromagnétique se décrit comme une onde, dont la longueur dépend de la température du corps qui l’émet. Le Soleil, dont la température de surface est de l’ordre de 6 000 °C, émet essentiellement dans des longueurs d’onde correspondant à la lumière visible, blanche, secondairement à des longueurs d’ondes plus faibles, les ultraviolets (UV), ou plus grandes, le proche infrarouge. La Terre, elle, à cause d’une température de surface beaucoup moins élevée, émet dans l’infrarouge moyen. Fourier reprendra l’explication de Saussure pour expliquer le mécanisme de son expérience :
« La chaleur acquise se concentre, parce qu’elle n’est point dissipée immédiatement par le renouvellement de l’air ».
Mais il va plus loin : selon lui, le verre n’est pas un obstacle au rayonnement solaire, il laisse passer les longueurs d’onde de la lumière visible. À l’intérieur de l’héliothermomètre, le fond noir qui s’échauffe va, lui, rayonner dans l’infrarouge, une longueur d’onde que le verre, nous dit Fourier, ne laisse pas passer. Le physicien français y voit plus qu’une analogie avec l’atmosphère terrestre :
« (…) la température peut être augmentée par l’interposition de l’atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d’obstacle pour pénétrer l’air, étant à l’état de lumière, qu’elle n’en trouve pour repasser dans l’air lorsqu’elle est convertie en chaleur obscure ».
Fourier décrit là le principe général de ce que l’on nomme aujourd’hui effet de serre. Bien qu’impropre, puisque le verre ne bloque qu’assez peu le rayonnement infrarouge, la comparaison avec la serre sera tellement parlante que l’effet de serre sera ainsi nommé, en dépit d’une expérience de 1909 menée par Robert William Wood ayant montré que le verre d’une serre, opaque au rayonnement infrarouge, n’augmente quasiment pas plus la température du dispositif que s’il est remplacé par un matériau aussi transparent à cette longueur d’onde qu’à la lumière visible. Le confinement, empêchant toute convection de l’air et donc son renouvellement, explique à lui seul le comportement thermique d’une serre.
De l’étude des glaciations au dioxyde de carbone
La contribution des montagnes à la découverte de l’effet de serre continue grâce à l’étude des glaciers. Durant le XIXe siècle, les montagnes suscitent un intérêt majeur aussi bien chez les artistes que chez les scientifiques. Ces derniers s’interrogent notamment sur les blocs erratiques, des blocs de roche dont la disposition échappe à toute explication rationnelle. « Les granites ne se forment pas dans la terre comme des truffes, et ne croissent pas comme des sapins sur les roches calcaires », écrit Saussure. De fait, bien souvent, ils ne peuvent être rattachés à la géologie locale. Par ailleurs ils se présentent parfois sous forme d’alignements de chaque côté d’une vallée alpine ou encore isolément, dans les plaines situées au pied des montagnes. Les explications imaginées pour justifier l’existence de ces blocs erratiques seront aussi variées qu’erronées. L’une d’entre elles fait même implicitement référence au Déluge en imaginant leur transport par des masses d’eau considérables. Bien avant tout le monde, c’est le scientifique écossais John Playfair qui aura la bonne intuition et expliquera l’existence des blocs erratiques par le mouvement des glaciers en 1802. Mais c’est l’ingénieur en chef du canton du Valais, Ignace Venetz, qui formula scientifiquement cette hypothèse. Dès 1821, dans son Mémoire sur les variations de température dans les Alpes, il explique que, par le passé, les glaciers ont connu des phases d’avancée et de recul. Lors des avancées ils ont poussé devant eux des débris de roches de taille très variable, laissés sur place lors des reculs. Sa thèse va à l’encontre de l’idée alors répandue que la Terre ne cesse de se refroidir depuis sa création, mais elle se répand peu à peu, jusqu’à ce que le savant suisse Louis Agassiz s’en empare et propose en 1837 l’existence de plusieurs âges glaciaires dans le passé de la Terre. Il l’expose dans son œuvre majeure en la matière Études sur les glaciers en 1840. Selon lui, non seulement les glaciers alpins se sont étendus jusque dans la vallée du Rhône, mais ils ont entièrement recouvert la Suisse. L’idée de fluctuations climatiques passées s’impose, mais leur explication reste à trouver. Deux thèses principales seront proposées : l’effet de serre d’une part, les variations de l’orbite terrestre de l’autre.
C’est en cherchant les causes possibles de ces périodes glaciaires que l’Irlandais John Tyndall a étudié les capacités d’absorption des gaz composant l’atmosphère. Il conclut en 1861 que cet effet de serre est dû principalement à la vapeur d’eau. Cette dernière et, plus secondairement, le dioxyde de carbone (on parle d’acide carbonique à l’époque) jouent un rôle important dans le climat de la Terre, si bien que des variations de leurs concentrations respectives peuvent expliquer ces changements climatiques :
« Un léger changement dans les constituants variables de l’atmosphère suffit pour que se modifie la quantité de chaleur retenue à la surface de la Terre enveloppée par la couverture d’air atmosphérique ».
Pour intéressante qu’elle soit, cette explication des vicissitudes climatiques du passé selon Tyndall achoppe sur un point important : quelle pourrait bien être l’origine de ces variations de concentration des gaz au sein de l’atmosphère ? On ne conçoit à l’époque qu’une origine possible : l’action humaine, ce qui ne peut être le cas pour ces époques reculées.
Bien qu’insatisfaisante, cette théorie des variations de concentration des gaz atmosphériques comme moteur des glaciations passées ne sombre pas dans l’oubli : elle est à nouveau utilisée par un brillant chercheur, Svante August Arrhenius, chimiste suédois qui reçut le prix Nobel de chimie pour un tout autre travail que celui qui nous intéresse ici. Les glaciations ont aussi retenu son attention et il cherche le mécanisme permettant d’expliquer les variations de température de l’atmosphère qui ont permis ces ères glaciaires. Dans un article intitulé De l’influence de l’acide carbonique de l’air sur la température de surface de la Terre, publié en 1896, il relie les évolutions des températures et de la concentration en dioxyde de carbone atmosphérique. Selon lui, un doublement en CO2 conduirait à une augmentation de la température moyenne de la Terre de 4 à 5 °C. Tout comme son collègue et ami Nils Eckholm, il appelait de ses vœux une telle évolution, pensant qu’une augmentation de température serait bénéfique pour tous, particulièrement pour l’agriculture. Mais il pensait qu’il faudrait attendre 3 000 ans avant que cela ne se produise. En 1906, il prétendra même qu’une telle concentration en CO2 pourrait retarder et atténuer la prochaine période glaciaire. Il réitère sa présentation d’un monde plus chaud favorable au bien-être des Hommes, ce qui amène quelque peu l’attention sur sa théorie, pour un temps seulement car elle va ensuite retomber dans l’oubli pendant quelques décennies.
La théorie astronomique des variations climatiques du passé n’a guère plus de succès. Selon elle, les variations que connaît la Terre dans sa manière de tourner sur elle-même et autour du Soleil seraient suffisantes pour expliquer les glaciations récemment reconnues. Elle est proposée pour la première fois en 1842 par un mathématicien français, Joseph Alphonse Adhémar. Mais les connaissances de l’époque sont trop lacunaires, les résultats du savant insatisfaisants : la théorie est accueillie plutôt froidement, avec même quelque virulence. Quelques années plus tard, le géologue écossais James Croll l’améliore, grâce à une meilleure connaissance des paramètres orbitaux de la Terre et de leur évolution, mais les variations cycliques de grande ampleur qu’ils imposent au système climatique sont encore trop mal appréhendées pour remporter l’adhésion.
Encore incomplète à l’aube du XXe siècle, la théorie astronomique des climats s’étoffera suffisamment moins de cinquante ans plus tard pour s’affirmer comme l’explication unique des vicissitudes climatiques d’un lointain passé. Quant à l’effet de serre, s’il n’a pu alors s’imposer comme élément d’explication, sa formulation a alors beaucoup progressé.
Lire les chapitres suivants sur hacene-arezki.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.